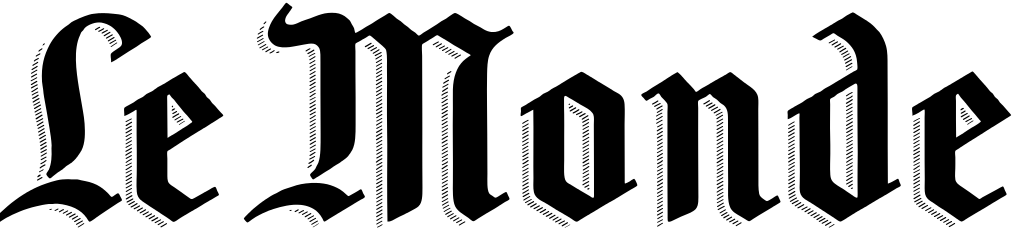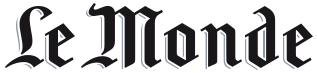Débats
Les articles dans la presse quotidienne
- 11 mars 2024
Tribune Les autorités religieuses, médicales et politiques qui pesaient hier « de toutes leurs forces » contre la loi Veil sont aujourd’hui à la manœuvre pour s’opposer à toute évolution de la loi sur la fin de vie, constatent, dans une tribune au « Monde », des médecins et des intellectuels, parmi lesquels la psychanalyste Sophie Cadalen et le philosophe André Comte-Sponville. Au moment où l’interruption volontaire de grossesse (IVG) devient une liberté gravée dans la Constitution, quel va être le contenu du projet de loi annoncé ce dimanche 10 mars par le président Emmanuel Macron, dans son entretien conjoint aux journaux La Croix et à Libération, face à la variété des situations de fin de vie ? Droit tant attendu par des malades qui refusent des souffrances « pires que la mort », comme le disait le philosophe Frédéric Worms dans un article de L’Obs du 8 décembre 2022, et qui demandent à « fermer la lumière » ? Voilà des années que les sondages le montrent invariablement : les Français sont favorables à une nouvelle loi qui leur reconnaîtrait le droit d’être aidés médicalement à abréger leur vie. Voilà bientôt un an que, au terme de travaux approfondis, respectueux et salués pour leur qualité exceptionnelle, la convention citoyenne sur la fin de vie s’est prononcée en faveur de la reconnaissance d’un droit pour une personne en situation de maladie incurable et de souffrances inapaisables de recevoir une aide au suicide ou de bénéficier d’une aide médicale à mourir, sur sa demande expresse et réitérée, dans un cadre légal. Les forces qui s’opposent aujourd’hui à la reconnaissance de ce nouveau droit rappellent celles qui, il y a cinquante ans, s’opposaient à l’IVG. Avec des arguments similaires. Pas la même écoute Les autorités religieuses, en premier lieu, qui, au nom de l’idée selon laquelle « la vie est sacrée », ont pesé de toutes leurs forces contre la loi Veil, adoptée en 1975. Ces derniers mois, elles ont fait le siège du gouvernement et du président Emmanuel Macron, qui les a invitées à plusieurs reprises pour entendre leurs arguments. Les associations qui militent pour la reconnaissance de ce nouveau droit et reçoivent les personnes en détresse n’ont pas droit à la même écoute. Les autorités médicales ensuite – le conseil de l’ordre des médecins et l’Académie nationale de médecine – qui, brandissant le serment d’Hippocrate et au nom du principe « tu ne tueras point », étaient farouchement opposées à l’avortement. Heureusement, des médecins bravant l’interdit venaient en aide aux femmes, comme certains aujourd’hui viennent en aide à leurs patients condamnés et souffrants qui demandent leur aide pour partir paisiblement sans attendre une issue implacable. Tout comme leurs prédécesseurs d’avant 1975, d’ailleurs, ces médecins continuent à être traduits en justice. Pourtant, la position de certaines institutions de poids commence à s’infléchir, comme l’Académie nationale de médecine, qui s’est récemment ralliée à l’idée d’un droit à « l’assistance au suicide », ou le Comité consultatif national d’éthique ouvrant la porte à une exception d’euthanasie. Elles constatent que, quand bien même ils seraient généralisés sur tout le territoire français, ce qu’on ne peut que souhaiter, les soins palliatifs ne répondent pas à toutes les situations ; de même que la contraception, pourtant libre et gratuite, ne répond pas à toutes les situations auxquelles sont confrontées les femmes. Défausse peu glorieuse Les autorités politiques enfin, qui fermaient les yeux sur les mouvements qui aidaient les femmes à se rendre au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, où l’IVG était autorisée ; aujourd’hui, elles ne paraissent pas gênées outre mesure par le fait que des Français n’aient comme autre solution que de chercher en Belgique ou en Suisse l’aide à mourir qui leur est refusée en France. Une défausse peu glorieuse et particulièrement inégalitaire, car réservée aux personnes informées et dont l’état de santé permet encore de supporter le déplacement, et disposant de moyens financiers importants. Qui aurait pensé qu’un jour l’IVG entrerait dans notre Constitution, a fortiori avec les suffrages venant de familles politiques qui ont férocement combattu sa légalisation en 1975 ? Si l’histoire est appelée à se répéter, que ce soit désormais non plus pour le pire, mais pour le meilleur. Pour que ce projet de loi ouvre réellement sur ce nouveau droit, il faut que le Parlement, quand il s’en saisira, soit le lieu d’un vrai débat démocratique qui n’esquive pas les oppositions pour aboutir enfin à la loi qu’attendent les Français. Comme, il y a cinquante ans, a été reconnu à chaque femme le droit de choisir de poursuivre ou non une grossesse et de disposer de son corps. Une loi de liberté, une loi de solidarité, une loi d’égalité. Laurence Bedossa, avocate ; Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine ; Chantal Calmat, médecin ; François de Closets, journaliste ; André Comte-Sponville, philosophe ; Denis Labayle, médecin et écrivain ; Henri Pena-Ruiz, philosophe ; Bernard Senet, médecin ; Anne Vourc’h, sociologue ; Annie Wallet, coprésidente de l’association Le Choix. Citoyens pour une mort choisie. Lire l’article sur le site du Monde
- 17 septembre 2023
Le Monde 07/09/2023 Le soin est souvent défini sans que l’on ait pris le temps de s’intéresser au point de vue du patient. C’est au malade de choisir si ces différentes conceptions doivent s’opposer ou devenir une offre complémentaire, estime le médecin Denis Labayle, dans une tribune au « Monde ». Le débat sur l’aide active à mourir bute souvent sur la question : s’agit-il d’un soin ? Quand on relit les définitions de « soins » dans les différents dictionnaires (Larousse et Le Robert, pour ne citer qu’eux), on trouve une multitude de termes, qui vont d’« actions par lesquelles on conserve et on rétablit la santé » à « attention, prévenance, sollicitude », avec même, dans Le Robert, le mot « guérir » apparaissant dans la définition de « soigner ». Si l’on ne devait parler de soin qu’en cas de guérison, l’association des mots « soins » et « palliatifs » serait un oxymore. Or personne ne remet en cause la valeur des soins proposés par les médecins qui se sont spécialisés dans cette pratique médicale. Alors, qui définit ce qui est ou n’est pas un « soin » ? Le législateur ? La médecine ? Le malade ? Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour préciser ce qui n’est pas un soin. En 2005, avec la loi Leonetti, et en 2016, avec la loi Claeys-Leonetti, il a rappelé aux médecins qu’au-delà d’une certaine limite leurs actes médicaux, même réalisés avec les meilleures intentions du monde, ne relèvent plus du domaine du soin mais de l’« acharnement thérapeutique ». Le législateur est également intervenu en 2002, avec la loi Kouchner, pour affirmer que le malade a le droit, dans certaines circonstances, de refuser les « soins » que le médecin lui propose quand ceux-ci s’avèrent trop coûteux en souffrances. Avec le temps, ces prétendus « soins » sont devenus de « faux soins ». Et l’interruption volontaire de grossesse, maintenant légalisée et médicalisée, est-elle un soin ? La réponse est évidente pour celles et ceux qui estiment que ce geste permet aux femmes d’éviter les conséquences d’une interruption clandestine capable de mettre en péril leur santé, et même leur vie. Mais d’autres maintiennent un avis contraire. Ainsi, pour le législateur, la notion de soin peut évoluer avec le temps : ce qu’il a criminalisé hier peut devenir un soin légal. Une notion terriblement trouble Alors est-ce au médecin de définir ce qu’est un soin ? Dans de nombreuses circonstances, en redonnant la santé à un malade atteint d’une affection curable, le médecin apporte ce qu’on pourrait appeler « l’idéal du soin ». Simultanément, il supprime les souffrances et allonge la durée de vie. Mais, même dans de telles circonstances, il peut se tromper. Après que le docteur Fernand Lamaze a introduit en France l’accouchement sans douleur, en 1951, il a été traduit à deux reprises devantle conseil de l’ordre des médecins pour cette méthode. Pourtant celle-ci a été reconnue comme un soin et remboursée par la Sécurité sociale cinq ans plus tard. De même, le monde médical a été longtemps réticent à prescrire de la morphine pour soulager la douleur, même en cas de maladie grave. Il a fallu attendre la loi de 2001 pour que ce soin évident deviennelégalement obligatoire. Récemment encore, la recherche médicale ne retenait que la durée de vie comme seul critère pour évaluer la qualité d’un soin thérapeutique, jusqu’au jour où fut introduite la notion de « qualité de vie » pour juger du progrès d’un traitement. Alors, quand le médecin est confronté à la maladie incurable, la notion de soin devient terriblement trouble. Pour l’instant, la seule définition retenue officiellement en France est celle des soins palliatifs, y compris pour le traitement de l’agonie. Or peut-on véritablement considérer comme des « soins » certaines attitudes prônées par la loi actuelle ? Obliger un malade atteint d’un cancer évolué à vivre malgré son désir d’en finir, et attendre qu’il souffre de douleurs intraitables pour répondre à sa demande, cela relève-t-il du soin ou d’une nouvelle forme d’acharnement médical ? Au malade de choisir De même pour le traitement de l’agonie : les propositions faites par la Haute Autorité de santé, en application de la loi de 2016, répondent-elles véritablement à une notion de « soins » ? Imposer un traitement de l’agonie basé sur la déshydratation du corps et sur une sédation fluctuante prolongeant la vie d’un corps qui n’a plus de conscience, est-ce le meilleur des soins à proposer au mourant ? Pour nombre de médecins, prolonger une telle agonie inutile et douloureuse ne peut pas être considéré comme un soin. Et si l’on demandait au malade sa définition du soin ? Car, après tout, il est le premier concerné. Sa réponse n’est pas univoque. Ce que certains considéreront comme un soin essentiel pour eux-mêmes ne sera pas partagé par d’autres. Ainsi, certains définiront comme « soin » tout ce qui les maintient en vie dans les meilleures conditions, suivant en cela leur conviction philosophique ou religieuse. D’autres, à l’inverse, attendent du soin qu’il mette définitivement fin à leurs souffrances et à une maladie devenue intraitable. Ces deux conceptions du soin doivent-elles s’opposer, ou devenir une offre complémentaire ? Au malade de choisir. Et, si certains médecins, au nom de leurs convictions, ont une vision restrictive du soin pour la fin de vie de leurs malades, qu’ils laissent les autres libres d’accompagner leurs malades jusqu’à la mort, car beaucoup de médecins silencieux estiment que c’est de leur responsabilité d’aider leurs concitoyens à partir en douceur, comme ils le désirent, l’objectif étant de leur épargner d’inutiles souffrances. Pourquoi les uns seraient-ils plus « soignants » que les autres ? Dans de nombreux pays, la pratique des uns respecte la pratique des autres. Sans anathème. Parce que la notion de soin dépend du regard de la société sur elle-même, des influences philosophiques et religieuses du moment, du regard du médecin sur sa pratique et du pays où il exerce. Aussi, pour une fois, ne pourrait-on pas laisser au malade atteint d’une affection grave et incurable le soin de définir ce que signifie ce mot pour lui ? Denis Labayle est médecin et ancien chef de service au centre hospitalier Sud-Francilien. Il est l’auteur, entre autres, de « Le Médecin, la liberté et la mort. Pour le droit de choisir sa fin de vie » […]
- 20 septembre 2022
Le Monde 20 septembre 2022 Le débat sur la fin de vie revient régulièrement dans l’actualité et reviendra tant que la société n’aura pas résolu le dilemme : doit-elle défendre la vie coûte que coûte ou autoriser dans certaines circonstances la priorité à la lutte contre la souffrance ? Quelle doit être sa priorité ? Un dilemme profond qui aboutit au heurt permanent entre deux camps farouchement opposés. La défense de la vie comme absolu est souvent lié à la reconnaissance d’une présence divine qui gère le début et la fin de l’histoire humaine. Toutes les religions monothéistes partagent, pour une fois, une même analyse : Dieu est maître de la vie. Il la donne et lui seul peut la reprendre. Avec une note de soumission dans le judaïsme, de fatalité dans l’Islam, et même de rédemption dans le christianisme. Ces religions reconnaissent la valeur humaine de lutter contre la souffrance, mais à condition que cette lutte ne s’oppose pas au dessein divin. A l’inverse, pour ceux qui ne croient pas en une divinité suprême ou qui croient en un mystère non personnalisé, la réponse est autre. Sils respectent la nature dans ce quelle apporte de positif à l’homme, ils s’opposent à ses méfaits, et défendent le principe que la lutte contre la souffrance peut, dans certaines circonstances, supplanter le maintien de la vie. Et pour atteindre cet objectif, ils demandent l’aide à la médecine. Ces deux points de vue, tout aussi respectables, sont, dans certaines circonstances, difficilement conciliables. Heureusement, le plus souvent, la médecine en combattant la maladie, permet simultanément de prolonger la vie et de lutter contre la souffrance. Ce résultat s’appelle la guérison. Mais il arrive parfois que la maladie prenne définitivement le dessus, devienne source de souffrances physiques et/ou psychiques qui rendent l’existence intolérable. La médecine s’avère alors incapable de satisfaire ces des deux désirs humains : vivre et ne pas souffrir. Qui doit l’emporter et au nom de quelles valeurs ? Est-ce une question de dignité comme l’affirment certains ? Pas sûr. Chaque camp peut trouver de la dignité dans la défense de sa position : dignité dans l’humble acceptation de son sort et dans sa soumission à Dieu. Ou à l’inverse, dignité dans le refus d’une souffrance inutile responsable de la déchéance du corps. Autrement dit, refus de voir disparaître ce qui fait le sel de la vie. Ces deux points de vue sont-ils conciliables ? Peut-on espérer un consensus ? C’est peu probable, tant les positions officielles sont opposées. Mais le consensus est-il nécessaire ? Ne pourrait-il pas reposer simplement sur le respect de la liberté de l’autre ? Transformer ce débat sur la dignité en un débat sur la liberté ? Que chacun puisse choisir en fonction de ses convictions, et n’impose pas à l’autre son point de vue, surtout quand il s’agit de la question ultime que l’être humain doit se poser, l’une des plus complexes à laquelle il doit répondre. Cette liberté de choisir sa fin de vie n’est-elle pas finalement conforme à l’esprit de laïcité de notre République qui impose à chacun de tolérer l’autre dans ses croyances et ses convictions ? Au législateur de permettre ce choix en toute honnêteté, sans chercher à biaiser. Permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen d’apporter une réponse personnelle à la dernière question de son existence.
- 10 février 2022
L’OBS 10 Février 2022 Il milite depuis plus de vingt ans pour que l’aide médicale à mourir soit autorisée en France. Dès 2007, le docteur Denis Labayle a lancé un manifeste de 2 000 soignants reconnaissant avoir pratiqué ce geste chez des malades incurables, manifeste à l’époque publié dans « le Nouvel Observateur ». Aujourd’hui, président de l’association Le Choix/citoyens pour une mort choisie – cofondée par une proche d’Anne Bert, qui, atteinte de la maladie de Charcot, est partie mourir en Belgique en 2017 – , il nous parle de son combat. Votre association milite pour la légalisation de l’aide active à mourir. Pourquoi cette cause vous tient-elle tant à cœur ? Pour deux raisons. La première est personnelle : les malades m’ont beaucoup appris pendant mes quarante années de vie hospitalière. J’étais gastro-entérologue, une spécialité où beaucoup de patients meurent de maladies graves, de cancers, de cirrhoses, ce qui n’est pas le cas dans toutes les disciplines. Cela m’a permis de comprendre que les personnes en fin de vie, souffrant de maladies incurables, ont des demandes très diverses. Certaines souhaitent partir doucement, grâce aux soins palliatifs, d’autres veulent en finir vite, quand elles l’ont décidé. Une phrase entendue plusieurs fois m’a frappé : « Je ne veux pas être accompagné, docteur, vous ne comprenez pas, je veux partir. » Quelle est la deuxième raison ? Néonaticides : la sociologue Julie Ancian se penche sur ces crimes « incompréhensibles » Arrêter d’avoir des enfants pour sauver la planète ? « La liberté de procréer est un droit fondamental, pas celle de prendre l’avion » L’hypocrisie de la société sur la question de la fin de vie. Tout le monde fait comme si l’aide active à mourir n’existait pas en France. Pourtant, elle existe et a toujours existé. Mais elle est aléatoire : soit vous avez un médecin compatissant et courageux et vous pouvez en bénéficier si vous le souhaitez, soit vous mourrez à petit feu, soit vous devez partir à l’étranger, à condition d’en avoir les moyens financiers. Cette disparité constitue une injustice profonde. Vous racontez d’ailleurs une anecdote surprenante concernant la famille Debré qui illustre cette injustice. Il y a quelques années, j’avais été invité à débattre dans une émission de télévision sur l’aide médicale à mourir avec Bernard Debré, grand professeur de chirurgie urologique. Nous venions d’exprimer sur le plateau notre total désaccord quand, à la sortie, bon prince, il m’a proposé de poursuivre la discussion autour d’un verre. C’est alors qu’il m’a raconté une histoire de famille allant à l’encontre de tout ce qu’il avait défendu à la télé. Il m’a expliqué comment son grand-père, l’illustre pédiatre Robert Debré, avait demandé, à 96 ans, sentant sa fin venir, à bénéficier d’une aide médicale à mourir. Ses proches avaient tenté de l’en dissuader. En vain. Face à sa détermination, ils ont fini par accéder à sa demande. Cette histoire montre bien que des personnalités peuvent soutenir publiquement un point de vue et agir différemment. Vous reconnaissez dans votre livre avoir vous-même pratiqué des aides médicales à mourir lorsque vous étiez chef du service de gastro-entérologie du centre hospitalier d’Evry dans les années 1990/2000. Tout à fait. Cette pratique était courante dans tous les services hospitaliers jusqu’au vote de la loi Leonetti de 2005. Quand vous commenciez l’internat, que vous arriviez dans un nouveau service, c’était enseigné mais uniquement par le bouche-à-oreille. On utilisait alors ce qu’on appelait les cocktails lytiques, c’est-à-dire l’association d’un morphinique, d’un neuroleptique et d’un antihistaminique. La décision était prise par l’équipe soignante en accord avec la famille qui nous disait : « Faites quelque chose, docteur, ce n’est pas possible que ça s’éternise ainsi… » Cette pratique permettait d’éviter au patient une agonie insupportable. La mort survenait très rapidement sous cette sédation intense, profonde et continue. Mais ces euthanasies clandestines « officielles », si je puis dire, n’étaient pas satisfaisantes dans la mesure où le premier concerné, le malade, restait souvent exclu de la décision. Avec le temps, j’ai pris systématiquement en compte son avis. C’est devenu pour moi la donnée essentielle. Avec mon équipe, nous instaurions un dialogue pour comprendre ce qu’il désirait vraiment. Une première loi sur la fin de vie, dite loi Leonetti, a été votée en 2005, puis révisée en 2016. Devenue la loi Clayes/Leonetti, elle a instauré la sédation profonde et continue. Vous estimez pourtant que cette loi n’est toujours pas satisfaisante. Pourquoi ? L’intitulé de la loi, qui parle de « sédation profonde et continue », est très bien, mais le texte d’application est hautement discutable tant dans ses indications que dans sa méthodologie. Concernant les indications, elles sont trop restrictives. Selon la loi, « la sédation est mise en œuvre dans un contexte d’urgence ou pour répondre à la souffrance réfractaire du patient » et lorsque « le pronostic est engagé à court terme ». Autrement dit, il faut que le patient soit vraiment en phase terminale et qu’il souffre « de douleurs intolérables et incontrôlables » pour pouvoir en bénéficier. Mais intolérables pour qui ? Pour le malade ou pour le médecin ? Incontrôlables depuis quand ? Huit jours ? Quinze jours ? Notre association recueille des témoignages de personnes dont la fin de vie d’un proche s’est mal passée. Soit leur proche n’a pas eu la sédation à laquelle il avait droit, soit il l’a eue dans de mauvaises conditions, trop tardivement le plus souvent. J’ai moi-même été confronté à ce cas de figure en janvier 2021. Mon frère âgé de 78 ans avait eu une hémorragie cérébrale responsable d’une hémiplégie massive. Il avait beau présenter toutes les indications pour bénéficier d’une sédation profonde et continue, les médecins n’étaient pas d’accord entre eux. Un premier médecin l’a mise en route, un autre l’a interrompue. Il a fallu attendre un mois d’une agonie inutile pour qu’elle lui soit enfin accordée. Vous reprochez aussi à la loi de ne pas prendre en compte tous les malades. Effectivement, elle ne prend toujours pas en compte les personnes qui, atteintes d’une affection comme un cancer incurable, n’en sont pas à l’agonie mais ne supportent plus leur dégradation progressive. Elle exclut également tous les patients atteints de maladies neurodégénératives à évolution lente comme la maladie de Charcot ou la maladie de Parkinson qui, à un stade évolué, entraînent […]
- 9 avril 2020
Libération 9 avril 2020 L’infection au Covid 19 n’aura pas fini de mettre en lumière nos erreurs et nos manques de réflexion en matière sanitaire. Cette politique de l’autruche ne date pas d’aujourd’hui, ni même d’hier, mais d’avant-hier. Trop longtemps nous avons fait confiance aux technocrates et aux idéologues libéraux de la santé. Après le manque de soignants par le blocage du numérus clausus (1971), après la diminution drastique des lits d’hospitalisation au nom d’une vision mercantile (moins 40% de lits en cinquante ans), nous découvrons le manque possible de médicaments du fait de la course au profit maximum des entreprises pharmaceutiques qui ont délocalisé leur production. Aujourd’hui, nous faisons également mine de découvrir les problèmes posés par la fin de vie. Notre société n’a jamais voulu réellement aborder les insuffisances de la loi française, dite Claeys-Léonetti, qui, pour limiter le recours à la « sédation profonde et continue », impose l’hospitalisation et refuse aux médecins généralistes la possibilité de se procurer en ville les produits nécessaires à cette sédation (En novembre, l’un d’entre eux a été suspendu pour avoir aidé des malades à mourir à leur domicile en utilisant du Midazolam que son épouse hospitalière lui avait procuré). Cette loi n’avait pas prévu non plus l’impossibilité d’hospitaliser des malades âgés par manque de lits d’hospitalisation. Le décret que vient d’émettre le premier ministre, le 28 mars, autorisant la vente en pharmacie du Rivotril intraveineux, a pour objectif d’éviter aux personnes agonisant en ville et dans les Ehpad de mourir dans les souffrances cruelles de l’asphyxie. Même si ce décret limite dans le temps l’autorisation de l’emploi du Rivotril intraveineux, il est une reconnaissance officielle de l’Aide Médicale à Mourir. Ce que beaucoup réclament depuis des années. Il est temps de reconnaître la valeur éthique et humaine des médecins qui ont le courage d’éviter à leur patient une agonie inutile et douloureuse. Toutefois, par la précipitation dans lequel il a été élaboré,ce texte ministériel pose trois problèmes de fond. Tout d’abord où est la collégialité nécessaire à une telle décision ? La loi Clayes-Léonettin’a rien précisé sur ce point essentiel.Comment la faire vivre quand on exerce seul au fin fond de la Lozère ou de la campagne bretonne ? En Belgique, en Hollande, la loi est claire : l’avis de deux médecins est nécessaire avant d’envisager une Aide Médicale à Mourir. Ensuite, la limitation du décret dans le temps. Pourquoi ce qui est considéré comme une solution humaine un jour ne le serait pas demain ? Voilà longtemps que la population, dans sa très grande majorité (près de 90%), réclame un changement de la loi qui l’autoriserait à bénéficier d’une mort choisie et sereine. Une demande qui se heurte à la surdité des autorités politiques, religieuses et parfois même médicales. Enfin, il manque dans ce décret l’élément essentiel : le choix du malade ou l’avis de la personne de confiance. Pourquoi refuse-t-on que les Directives anticipées soient un véritable testament, laissant à chacun la liberté de choisir sa fin de vie ? Pourquoi les législateurs ont-ils limité la validité des Directives anticipées au cadre restrictif d’une loi incomplète ? Une fois éloignée, la pandémie au Covid 19 va-t-elle nous amener à reconsidérer autrement les problèmes de la maladie, de la souffrance, de la fin de vie. Nos hommes politiques vont-ils enfin ouvrir les yeux sur ces erreurs et ces manquements que nous avons été nombreux à dénoncer depuis longtemps ? Va-t-on enfin prendre conscience que ce problème particulièrement aigu du« tri des patients » qui choque tant de gens aujourd’hui, existait chez nous de façon chronique, du fait de la diminution du nombre drastique de lits d’hospitalisation ? Qu’un tri médical totalement inhumain, existe également depuis longtemps entre pays riches et pays pauvres, sans que cela ne brutalise les bonnes consciences ? Sans parler des millions de réfugiés dont beaucoup vont être livrés à une mort certaine. Y aurait-il dans la défense de l’éthique médicaledeux poids, deux mesures ? Espérons que dans six mois, quand la pandémie commencera à se lasser de notre terre, nous n’oublierons pas nos erreurs passées et que nous mettrons fin à une politique hypocrite et mercantile de la santé. Une politique qui va nous coûter cher. Docteur Denis Labayle, Médecin hospitalier. Auteur de : La vie devant nous, enquête sur les maisons de retraite (ed. Seuil), Tempête sur l’hôpital (ed. Seuil), Pitié pour les hommes (ed. Stock) Coprésident du CHOIX, Citoyens pour une mort choisie Docteur Bernard Senet, Médecin généraliste, membre du Collège décisionnel du CHOIX, Citoyens pour une mort choisie. Docteur Martin Winckler, médecin, et écrivain. Président du comité d’honneur de l’association Le choix. Citoyens pour une mort choisie.
- 21 septembre 2004
Désolé, cher monsieur, mais, après examen de votre dossier médical, nous ne pouvons vous accorder de prêt bancaire. » Cette réponse, aujourd’hui, ne nous surprend plus. Le banquier ne va pas prendre le risque de prêter de l’argent à un citoyen susceptible de tomber malade ou atteint d’un handicap. Une santé aléatoire rend la vie professionnelle difficile et les remboursements incertains. Cette logique financière est, dans notre société, implacable !
- 18 août 2003
Si l’on juge de la qualité d’un navire et de la fiabilité de son équipage, non pas par temps calme, mais lors d’une tempête, on peut estimer que le navire « santé publique » va mal. Plusieurs milliers de morts en quelques jours. Une hécatombe ! Certes, on peut comme le capitaine-ministre accuser la nature, mais on peut également mettre en cause la qualité de la structure et la compétence de ceux qui la dirigent. Car la canicule a bon dos ! Bien sûr l’événement est unique, bien sûr il était imprévisible, mais il y a trois ans nous assistions à la tempête du siècle, aujourd’hui c’est un autre caprice météorologique, demain ce seront des inondations ou une épidémie. Gouverner c’est prévoir, y compris dans le domaine de la santé.
- 2 octobre 2001
« Rennes en quarantaine… », « vingt-cinq foyers de variole déclarés à ce jour… », « Premiers cas d’anthrax diagnostiqués chez 350 passagers d’un Boeing 747 en provenance de Karachi… », « L’aéroport de Roissy, zone interdite, zone contaminée… ». On peut facilement imaginé les gros titres de la presse si le bioterrorisme se manifestait. Pure fiction ? Fantasme médiatique pour donner des frissons aux nantis ?
- 8 septembre 1998
Les démunis âgés sont nombreux, et le silence du monde politique assourdissant. L’assemblée nationale a adopté à l’unanimité, le 14 janvier, une proposition de loi en faveur des chômeurs de plus de 60 ans. Le projet doit permettre à quelques milliers de chômeurs ayant cotisé pendant quarante ans de partir à la retraite avant l’âge fatidique.
- 30 juillet 1998
Nul ne connaît, pour l’instant, les conditions exactes dans lesquelles ont eu lieu les faits reprochés à Christine Malèvre, l’infirmière de l’hôpital François-Quesnay de Mantes-la-Jolie (Yvelines), mise en examen pour avoir « mis volontairement fin aux souffrances de ses patients. » Un substitut de Versailles a toutefois reconnu qu’elle n’avait agi « ni pour l’argent, ni par intérêt, ni à la demande d’une quelconque association ».